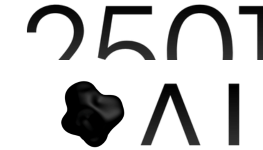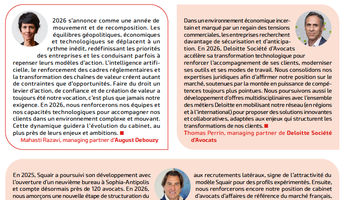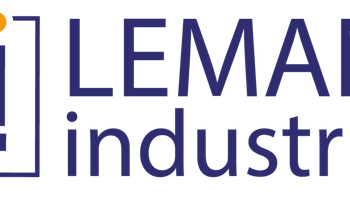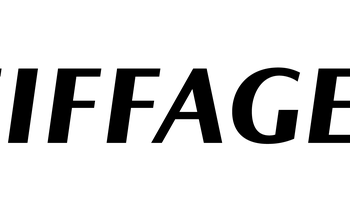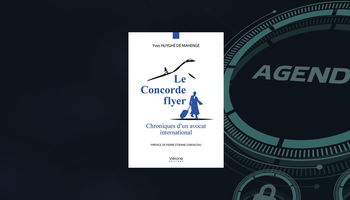Premier aperçu de la refonte du régime des nullités en droit des sociétés
Dans le cadre de l’habilitation donnée l’an dernier (loi « Attractivité » du 13 juin 2024), le gouvernement a adopté l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, réformant en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Si l’objectif affiché était celui de la clarification et de la sécurisation, les praticiens formulent certaines réserves quant à sa portée. Ce court article brosse d’un trait les principaux points de cette évolution notable du droit des sociétés.
Le contexte de la réforme. Ce texte réforme le régime des nullités en droit des sociétés en vue de « renforcer la sécurité juridique, en circonscrivant le risque de nullités et les incertitudes liées à leur mise en œuvre »(1).
L’objectif de la réforme. L’objectif de la réforme est double : la sécurisation et la clarification du régime des nullités en droit des sociétés, qu’il s’agisse de la nullité de la société elle-même ou de ses « décisions sociales »(2). À noter que ce dernier terme remplace celui d’« actes et délibérations », source d’ambiguïté et d’incertitude.
L’application dans le temps de la réforme. La réforme entrera en vigueur au 1er octobre 2025. Le droit antérieur continuera de s’appliquer aux décisions sociales prises avant cette date.
Une meilleure sécurité juridique du régime
des nullités en droit des sociétés
Le contrôle du « triple test »(3). L’un des apports majeurs de la réforme consiste en l’introduction d’un mécanisme de contrôle de la nullité des décisions sociales, devenue facultative par principe. L’action en nullité ne pourra prospérer que lorsque trois conditions cumulatives seront réunies : (i) l’irrégularité doit avoir lésé les intérêts du demandeur (ce qui devrait normalement être le cas si l’action est recevable) ; (ii) elle doit avoir influencé la décision ; (iii) les conséquences de la nullité pour l’intérêt social doivent être proportionnées à celles de l’atteinte à l›intérêt dont la protection est invoquée. Ce test est impératif, toute clause contraire étant réputée non écrite(4).
La nullité n’est plus nécessairement rétroactive(5). La réforme limite les effets de la nullité en permettant au juge de les différer lorsque leur rétroactivité risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social. Ce mécanisme, s’inscrivant dans la continuité du critère de proportionnalité, vise à prévenir le phénomène de « nullités en cascade »(6).
Ces mesures renforcent considérablement les pouvoirs du juge en la matière, ce qui soulève une interrogation classique quant à l’objectif de sécurité juridique affiché par la réforme. Il est permis d’espérer que la jurisprudence précisera rapidement les contours de ce contrôle.
La réduction du délai de prescription(7). L’ordonnance réduit le délai de prescription des actions en nullité de trois à deux ans, avec un point de départ maintenu au jour où la nullité est encourue. Ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (à savoir le 1er octobre 2025), sans que la durée totale puisse excéder le délai de prescription prévu par la loi antérieure (à savoir trois ans)(8). Des délais plus courts restent toutefois prévus pour certaines opérations spécifiques (augmentations de capital, fusions et scissions). Pour les sociétés cotées, il est même prévu que l’action en nullité d’une augmentation de capital non réservée n’est plus recevable dès l’opération réalisée.
La clarification du régime des nullités en droit des sociétés
La réorganisation des sources de droit commun des sociétés. Le droit commun des sociétés est désormais regroupé aux articles 1844-10 et suivants du code civil, après l’abrogation des dispositions générales figurant dans le code de commerce, notamment de l’article L 235-1. Cette réorganisation vise à renforcer la sécurité juridique en rationalisant les sources du droit en la matière.
La nullité pour « violation d’une disposition impérative du droit des sociétés »(9). La réforme remplace le critère formel de localisation des règles – au titre IX du livre III du code civil – par un critère matériel, limitant désormais les causes de nullité des décisions sociales aux « violations d’une disposition impérative du droit des sociétés » et aux causes générales de nullité des contrats. Bien que cette évolution vise à simplifier et unifier les fondements de la nullité des décisions sociales, elle soulève des inquiétudes. En effet, la suppression de l’exigence d’une « disposition expresse », couplée à l’incertitude entourant la notion de « disposition impérative du droit des sociétés », pourrait élargir de manière excessive les causes de nullité, fragilisant ainsi l’objectif de sécurisation des décisions sociales.
S’agissant, enfin, des SAS, la réforme supprime l’alinéa 4 de l’article L.227-9 du code de commerce, sur le fondement duquel la jurisprudence Larzul II (10) avait admis qu’une décision collective prise en violation des clauses statutaires puisse être annulée, et introduit un nouvel article L.227-10-1, autorisant les statuts à prévoir « la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies ». Cette évolution, qui renforce la force obligatoire des statuts, soulève deux critiques : (i) le risque de l’introduction de clauses de style dans les statuts de SAS, augmentant de fait les risques de nullité(11), et (ii) la pertinence de l’exclusion d’autres formes sociales reposant sur une même logique statutaire que la SAS – telles que les SNC(12). Elle amènera vraisemblablement les SAS à adapter leurs statuts en conséquence de ce qui précède. T