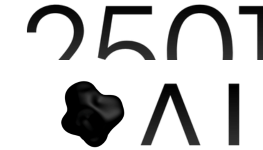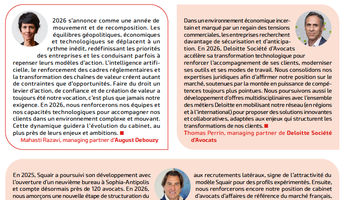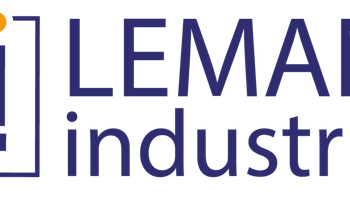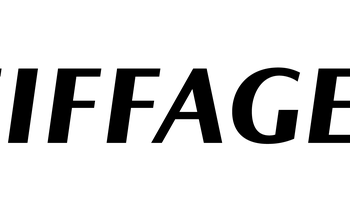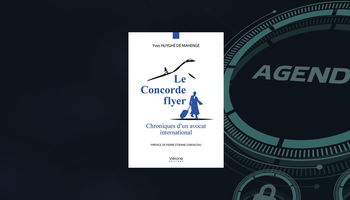Enquêtes de concurrence : la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur des perquisitions intervenues au domicile d’un salarié
En matière de concurrence, l’article L. 450-4 du code de commerce permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser les opérations de visite et saisie «en tous lieux», même privés. On observe en pratique que les autorités de concurrence, telles que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou l’Autorité de la concurrence, procèdent davantage que par le passé à des perquisitions au domicile privé de salariés d’entreprises faisant l’objet d’une enquête pour pratiques anticoncurrentielles.
C’est dans ce contexte que, dans un arrêt du 8 avril 2025(1), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer pour la première fois sur les conditions permettant d’autoriser une visite et une saisie au domicile privé d’un salarié. Cette question revêt une importance particulière à l’heure où le télétravail se généralise, rendant de plus en plus probable la présence de documents professionnels au domicile des salariés.
Dans l’affaire en question, des perquisitions avaient été réalisées au sein des locaux de huit entreprises du secteur des articles de puériculture ainsi qu’au domicile privé de la directrice commerciale d’une de ces entreprises. Les enquêteurs soupçonnaient ces entreprises d’avoir mis en œuvre des politiques de prix concertées.
La salariée perquisitionnée a formé un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé ces opérations. Son recours a été rejeté et elle s’est pourvue en cassation.
Absence d’exigence d’une motivation spécifique pour les perquisitions au domicile privé
La salariée soutenait que les perquisitions au domicile privé devaient être spécialement motivées, au moins par des éléments laissant présumer son implication personnelle dans les pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a rejeté cet argument, considérant qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’indices laissant présumer la participation du salarié concerné aux pratiques en cause. Il suffit qu’il existe des indices laissant présumer que des documents se rapportant à l’infraction sont susceptibles de s’y trouver.
Ce raisonnement ne nous semble pas critiquable dans son principe dans la mesure où imposer la démonstration d’une implication personnelle du salarié pour justifier de telles opérations aurait conduit à un alignement du régime des articles L. 420-1 (ententes) et L. 420-2 (abus de position dominante et abus de dépendance économique) avec celui de l’article L. 420-6 du code de commerce qui prévoit des sanctions pénales pour les personnes ayant pris une part personnelle, déterminante et frauduleuse dans une pratique anticoncurrentielle. En revanche, c’est l’appréciation du caractère sérieux des indices pour autoriser de telles opérations qui pose question.
La Cour de cassation s’est contentée de relever que les perquisitions étaient justifiées par le fait que la salariée exerçait ses fonctions professionnelles à son domicile, rendant plausible la présence de documents relatifs à la fraude présumée.
Dans le cas d’espèce, la société de la salariée n’a pas eu de bureau en France pendant plusieurs années. Durant cette période, la salariée a travaillé exclusivement, puis occasionnellement, depuis son domicile, qui constituait alors son principal lieu de travail, ce qui renforçait la probabilité d’y trouver des éléments pertinents pour l’enquête.
Des conséquences à surveiller à l’ère
du télétravail
Il convient de s’interroger sur la portée de cette décision. On perçoit mal, en effet, si ce sont les circonstances de l’espèce qui ont permis de déduire l’existence d’indices sérieux laissant présumer que des documents se rapportant à l’infraction étaient susceptibles de se trouver au domicile du salarié, ou si cela traduit une approche générale de la Haute juridiction. Quoiqu’il en soit, la motivation retenue, à la fois générale et succincte, pourrait à l’avenir justifier des perquisitions au domicile de tout salarié exerçant en télétravail, même de manière occasionnelle.
Cet arrêt semble s’inscrire dans une tendance d’une lecture toujours plus restrictive de la Cour de cassation des droits des entreprises perquisitionnées en matière de concurrence et de leurs salariés(2).
La position de la Cour de cassation s’éloigne ainsi sur plusieurs questions des standards posés notamment par la Cour européenne des droits de l’Homme, cette dernière rappelant régulièrement que les États disposent d’une marge de manœuvre plus restreinte lorsqu’il s’agit de porter atteinte aux droits à la vie privée, au domicile et à la correspondance des personnes physiques(3). Il n’est ainsi pas exclu que les cours européennes soient appelées, à l’avenir, à statuer sur la compatibilité de la jurisprudence française avec les standards européens de protection des droits fondamentaux.