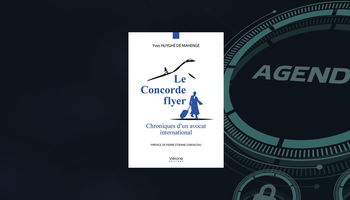Que doit-on attendre du Grenelle du Droit ?
Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N° 1323 du 30/10/2017
Le 16 novembre prochain, en partenariat avec la LJA et Droit & Patrimoine, la maison de la Mutualité accueillera le Grenelle du droit. Une journée de réflexion entre professionnels du droit pour discuter de l’avenir de la filière juridique. A la fin de la journée, l’objectif est d’obtenir des engagements visant à favoriser l’attractivité du droit français et l’employabilité des acteurs du secteur. Qu’est ce qu’en attendent les participants ? L’avis de quatre participants.
Nicolas Guérin, président du Cercle Montesquieu

L’objectif du Grenelle du Droit qui se tiendra le 16 novembre à la Maison de la Mutualité est de réunir, pour la première fois, tous ces professionnels du droit pour réfléchir ensemble à l’avenir de la filière juridique en France. Concrètement, nous ne souhaitons pas que le Grenelle du Droit soit un énième colloque sur le droit en France. Nous l’avons conçu comme une plateforme de réflexions qui devra déboucher sur des propositions concrètes aux pouvoirs publics.
Une réflexion sur le renforcement de la compétitivité du droit français
Nous devons faire reconnaître la filière du droit comme une filière unie, dynamique, génératrice de valeurs et d’emplois. Cette filière existe : pour la renforcer, il faut faire tomber les corporatismes, et envisager la filière dans sa globalité.
La filière juridique dans son ensemble est confrontée aujourd’hui à la révolution digitale qui est à la fois une contrainte d’évolution mais surtout une formidable opportunité. Nous devons appréhender cette révolution en nous tournant vers l’avenir plutôt qu’en s’arcboutant sur nos prérogatives d’aujourd’hui. C’est par l’innovation que la filière juridique se transformera au bénéfice non seulement des praticiens d’aujourd’hui mais surtout des générations futures de juristes, quel que soit leur mode d’exercice du droit.
Concrètement, j’attends du Grenelle du droit une réflexion sur le renforcement de la compétitivité du droit français et sur la transformation nécessaire de la formation, initiale et continue. Je souhaite que tous les contributeurs de ce premier Grenelle du Droit soient fiers d’appartenir à la filière juridique, soient capables de la promouvoir et de la faire évoluer pour les générations futures.
Stéphanie Fougou, présidente de l’AFJE

En réunissant les professionnels du droit et leur représentant, nous attendons que le Grenelle soit un moment d’échanges constructifs, porteurs d’une ambition commune. Nous considérons le Grenelle du droit comme un premier pas pour renforcer la filière juridique et activer ses changements en faisant tomber les barrières, sortir des segmentations artificielles dépassées et en apportant une vision complète et forte pour les juristes d’aujourd’hui et surtout ceux de demain.
Générer une plateforme de propositions concrètes destinée à alimenter les décisions des pouvoirs publics, du gouvernement et du Parlement
Le Grenelle du droit sera un lieu d’écoute, pragmatique et créatif qui permettra à toutes les professions du droit de poser les bases et les directions que nous devrons prendre ensemble.
L’objectif est clair : fédérer les professionnels du droit sur ce qui nous rassemblent et d’obtenir des engagements quant à la mise en œuvre de ces mesures essentielles pour l’attractivité du droit français, la compétitivité de nos systèmes juridiques et à renforcer l’employabilité et la mobilité des professions en sortant des visions corporatistes qui pénalisent la force du droit français.
Le droit prend une place prépondérante dans un monde en grande transformation, la filière juridique doit être unie, organisée, un meilleur interlocuteur et donc l’un des principaux acteurs de l’entreprise et de la vie économique. Le grand enjeu auquel nous souhaitons répondre avec le Grenelle du droit, est de préparer nos métiers à cette transformation profonde de nos sociétés.
Kami Haeri, avocat

Ne nous y trompons pas : les efforts méritoires de chaque profession n’arriveront jamais à atteindre le niveau d'efficacité d'une action collective et concertée. C'est la raison pour laquelle il faut se réjouir qu’une initiative telle que le Grenelle du droit ait été mise en œuvre : désormais, juristes d’entreprise, avocats, professeurs de droit et chercheurs, régulateurs, consommateurs de droit, prennent date pour entamer ensemble une refonte de nos réflexions au sujet du droit, de son avenir et de ce que le citoyen en attend.
La question de la mobilité devra être abordée. Elle est centrale
Désormais, le numérique redéfinit l'accessibilité au juriste et le statut de celui-ci. Il oblige celui-ci à structurer différemment une partie de son activité afin de se repositionner sur les conseils à forte valeur ajoutée. Il établit un pont plus solide, plus immédiat, entre juristes et avocats du monde entier, accélérant au passage la globalisation du droit. Enfin il modifie le rapport entretenu jusqu'ici à l’apprentissage et au knowledge management. Nous pouvons choisir de voir cette révolution anthropologique comme une menace. Nous pouvons surtout choisir de l'appréhender comme une opportunité de transformer nos organisations de les rendre plus agiles et plus interopérables, plus ouvertes au monde.
De même, la question de la mobilité devra être abordée. Elle est centrale. Les jeunes juristes expriment avec enthousiasme leur désir de mobilité. Ils ont raison. Comment aujourd'hui leur imposer une lecture ancienne et linéaire du parcours du juriste ou de l’avocat, dédié à une seule et même famille d’exercice ?
Nous devons imaginer ensemble ces professions nouvelles du droit, au sein desquels le juriste qui le souhaite pourra pratiquer en entreprise, puis en cabinet d’avocat, puis chez un régulateur, sans que jamais ces changements ne puissent être synonymes de renoncement ou de dépit. Nous devrons imaginer dans les années qui viennent les formations nouvelles, l'apprentissage des softs skills, qui permettront au juriste français de s'exprimer avec son intelligence sociale et émotionnelle, sa créativité et sa capacité de régler des problèmes complexes à Paris, à Singapour ou à Lima. C'est le défi des 10 prochaines années. C'est l’objectif de cette passionnante journée de réflexion et d'échanges.
Professeur Antoine Gaudemet, Paris II Panthéon-Assas

■ s’il est légitime que certaines formations juridiques puissent ne pas avoir de débouchés professionnels immédiats, car la mission de l’université est aussi de produire et de conserver des savoir académiques, les étudiants devraient pouvoir disposer d’une information pertinente sur leurs perspectives professionnelles avant d’intégrer telle ou telle formation juridique ;
■ il conviendrait de condamner le discours démagogique consistant à tenter d’imposer un taux de réussite élevé aux diplômes universitaires : la sélection à l’université est une garantie de l’insertion professionnelle de ses diplômés ;
■ les études juridiques offrent déjà plusieurs types de formation initiale, dont certains répondent à la demande aujourd’hui dominante de « pluridisciplinarité », avec l’idée que les parcours professionnels conduiront à occuper des fonctions différentes au cours d’une même vie professionnelle : on peut se demander si l’aptitude à évoluer professionnellement ne devrait pas relever davantage du développement de l’offre de formation continue, qui reste insuffisante à l’université ;
Des propositions concrètes de nature à renforcer la professionnalisation des études de droit
■ dans la formation initiale dispensée par l’université, le caractère professionnalisant de la licence n’est certes pas évident, mais il faut admettre que la licence doit conserver un caractère généraliste et que les effectifs y sont tels que les moyens affectés à la professionnalisation des étudiants s’en trouvent nécessairement réduits. En revanche, les actions de professionnalisation conduites auprès des étudiants devraient être renforcées (aide à l’orientation, stages, ateliers de CV, de lettre de motivation, etc.) et davantage de licences professionnelles spécialisées pourraient être créées en accord avec les professionnels concernés (collaborateurs d’études notariales, secrétaires juridiques, cadres intermédiaires de la fonction publique, etc.);
■ dans la formation initiale dispensée par l’université, le renforcement du caractère professionnalisant du Master 1 est en revanche stratégique (le caractère professionnalisant des Masters 2 étant probablement le plus abouti à l’heure actuelle) : le développement des « unités d’expérience professionnelle » (possibilité pour les étudiants de M1 d’effectuer un semestre dans une entreprise ou un cabinet, sous le double tutorat d’un enseignant et du maître de stage) devrait être favorisé ; des enseignements professionnalisant (comptabilité, analyse financière, plaidoiries, etc.), valorisant le travail de groupe et l’expression orale, devraient être introduits ; l’année de césure, qui tend à se répandre, pourrait être mieux valorisée sur le plan professionnel.